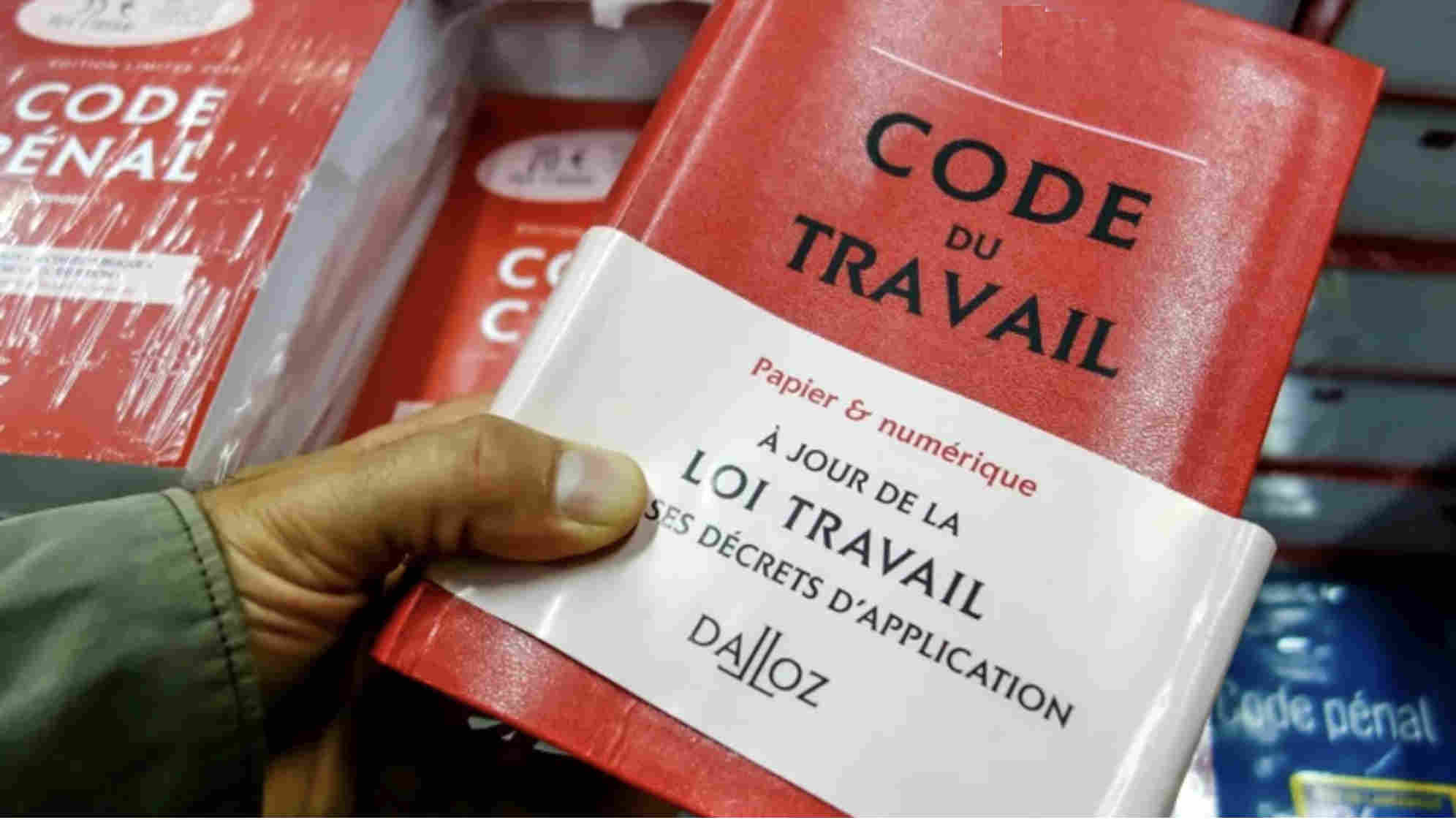En ce 1er mai 2025, alors que le monde célèbre la Journée internationale du travail, les travailleurs camerounais peinent à trouver des raisons de se réjouir. Malgré des engagements répétés, l'État semble sourd aux appels à un travail décent, laissant les citoyens dans une précarité persistante. Plongée dans les fissures d’un système marqué par un cadre juridique solide, mais une application fantôme.
Au Cameroun, le 1er mai devrait être une journée de célébration pour les travailleurs. Pourtant, pour beaucoup, c'est une journée de rappel amer des promesses non tenues. Le Code du travail camerounais prévoit des protections pour les travailleurs, notamment contre les licenciements abusifs et pour le respect des droits syndicaux. Cependant, dans la réalité, ces droits sont souvent bafoués. Les travailleurs des plantations de canne à sucre, par exemple, subissent des conditions de travail déplorables, des arriérés de salaires et une répression syndicale systématique .
Un horizon assombri par des promesses non tenues
Le 14 mai 2024, le gouvernement camerounais, en partenariat avec l'Organisation internationale du travail (OIT) et les partenaires sociaux, signait un protocole d'accord tripartite visant à promouvoir le travail décent, renforcer la protection sociale et encourager le dialogue social . Cet engagement, inscrit dans le Programme Pays pour le Travail Décent (PPTD) 2023-2026, semblait tracer la voie vers une amélioration des conditions de travail.
Cependant, un an plus tard, les résultats tangibles se font attendre. Les travailleurs continuent de faire face à des conditions déplorables : absence de contrats de travail, salaires dérisoires, retards de paiement, harcèlement moral et sexuel, et manque de sécurité sociale . Le sous-emploi touche environ 65 % des travailleurs, selon l'Institut national de la statistique.
Des jeunes diplômés contraints de retourner à la terre
Face à un marché du travail saturé et peu accueillant, de nombreux jeunes diplômés se tournent vers l'agriculture pour survivre. Des initiatives comme l'association "Un diplômé un champ" ont permis à certains de se reconvertir avec succès, malgré les obstacles financiers et le manque de soutien institutionnel .
Ahmed Ngouh Mounchikpou, titulaire d'une licence en physique, a ainsi quitté la capitale pour cultiver des bananes plantains et du macabo dans son village natal. Malgré les moqueries et l'absence de soutien familial, il a réussi à créer une activité rentable. Cependant, ces réussites individuelles ne sauraient masquer l'inaction de l'État en matière de création d'emplois décents pour les jeunes.
Une législation inadaptée
La Loi de finances 2024 a introduit des mesures fiscales qui ont alourdi les charges des travailleurs sans mécanismes de compensation. L'augmentation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et l'imposition des avantages en nature ont réduit le pouvoir d'achat des salariés, déjà mis à mal par une inflation estimée à 8 % en 2023 .
Le Mouvement travailliste du Cameroun a dénoncé ces mesures comme étant "non inclusives" et "inéquitables", soulignant l'absence de redistribution équitable des fruits de la croissance économique.
Des droits fondamentaux bafoués
Au-delà des conditions de travail, les droits fondamentaux des travailleurs sont régulièrement violés. Les syndicats et les organisations de défense des droits humains font face à des intimidations, des arrestations arbitraires et des suspensions injustifiées. En décembre 2024, le Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale (REDHAC) a été suspendu pour trois mois par le ministère de l'Administration territoriale, sans fondement légal, selon Human Rights Watch .
Ces atteintes aux libertés syndicales et associatives entravent la lutte pour des conditions de travail décentes et renforcent le sentiment d'impunité des employeurs peu scrupuleux.
Vers une prise de conscience collective
La célébration de la Journée internationale du travail doit être l'occasion pour le Cameroun de faire un bilan honnête de la situation des travailleurs et de prendre des mesures concrètes pour améliorer leurs conditions. Dans cette lancée, il est impératif que les engagements pris dans le cadre du PPTD soient suivis d'actions tangibles, avec une implication réelle des partenaires sociaux et de la société civile.
L'État doit prendre ses responsabilités et œuvrer véritablement pour la promotion d'un travail décent, garant de la dignité humaine et du développement durable.
Il est temps que l'État camerounais passe des paroles aux actes. Les travailleurs méritent des conditions de travail dignes et le respect de leurs droits fondamentaux. En ce 1er mai, rappelons que le travail décent n'est pas un luxe, mais un droit.
Étienne TASSÉ